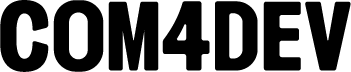Pourquoi capitaliser ?
Identifier et partager des innovations, des outils, des démarches.
Devenir une organisation apprenante, ne pas “réinventer la roue”.
Replacer l’expérience des acteurs au cœur du développement.
Fédérer les équipes.
Repenser ses interventions (au regard des expériences).
Convaincre par la preuve.
Récolter les fruits de l’expérience (résultats).
Permettre la réplication des actions (en mieux).
Les plus
- Processus qui ne nécessite pas forcément de gros moyens
- Tout le monde peut capitaliser
- Fédère les équipes
- Plus formateur que l’évaluation des projets
- Exercice qui valorise les auteur.trices (leur parole, leur savoir)
Les moins
- C’est un long processus
- L’écriture peut être un frein
- Difficulté à admettre l’échec
3 méthodes
- Capitalisation par un tiers : tout le processus est confié à un tiers, généralement un “expert” qui anime un exercice de maïeutique pour faire accoucher de l’expérience.
- Auto-capitalisation : la capitalisation est effectuée par les acteur.trices de l’action.
- Une méthode mixte avec un appui extérieur à l’auto-capitalisation (méthode généralement privilégiée).
Quelles étapes ?
- Mobiliser une équipe de “capitaliseur.trices”.
- Identifier l’objet de la capitalisation (innovations par exemple). Cela peut demander une étude préalable ou la tenue d’ateliers participatifs.
- Identifier les outils de capitalisation (on peut utiliser des fiches, des histoires de vie, des vidéos, des enregistrements audio, des ateliers de partage, foires aux savoirs…)
- Planifier le processus.
- Dans le cas d’auto-capitalisation, organiser des formations à la capitalisation.
- Faciliter le processus d’écriture en dédramatisant par des formations, des ateliers, des appuis extérieurs.
- Élaborer un plan de diffusion de la capitalisation et le mettre en œuvre.